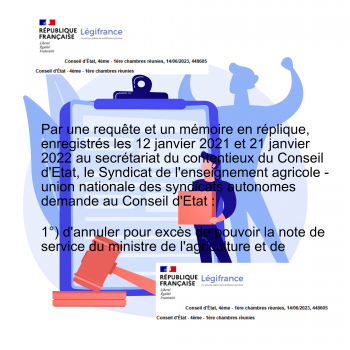Après plusieurs mois d’un parcours parlementaire chaotique, la loi d’orientation agricole arrive finalement à son terme et vient d’être adoptée par le Parlement. Rappelons que cette loi fixe et donne les orientations stratégiques du MASA pour les dix prochaines années. L’enseignement agricole en tant que système éducatif au service des politiques publiques du ministère en est donc directement dépendant.
Le SEA-UNSA exprime son incompréhension face à la teneur finale du texte sur la question environnementale.
L’un des objectifs premiers du texte était de répondre à la crise environnementale par les transitions et l’agroécologie. Or, de manière caricaturale, la droite sénatoriale s’est efforcée d’expurger du texte toute mention de « l’agroécologie ». Le texte passe ainsi de vingt occurrences du terme après les travaux de l’Assemblée nationale à zéro après ceux du Sénat. Le gouvernement et Madame la Ministre n’ont opposé à cela qu’une contradiction timide et se sont satisfaits de la réintroduction du terme « transition » à la place de celui « d’adaptation ». Adaptation et transition sont pourtant indissociables et devraient apparaître de manière conjointe dans une loi ayant pour objectif de transformer l’agriculture dans un contexte de changement climatique.
Le SEA-UNSA s’inquiète des conséquences de ce renoncement dans le champ de l’éducation.
Quel va être dans ces conditions l’avenir du plan EPA2 (enseigner à produire autrement, par les transitions et l’agroécologie) alors que tous les acteurs s’accordent à dire que des signaux politiques contraires désorientent et découragent les équipes ? Quoi qu’imparfaits ce sont bien les deux plans EPA successifs qui ont permis d’enclencher la transition agroécologique dans l’enseignement agricole. Sans soutien politique la démarche risque fort de s’essouffler et les difficultés ne seront pas surmontées.
Le SEA-UNSA affirme que les efforts doivent être accentués, que la dynamique collective doit se poursuivre : ne cassons pas la lente construction des dix dernières années et les acquis des plans EPA et EPA2. Cela doit se traduire, entre autres, par une présence accrue de l’agroécologie dans les référentiels de formations.
Outre ces aspects, le texte de loi comprend des acquis réglementaires qui, s’ils ne donnent pas d’orientation forte ni d’élan, n’en apportent pas moins certaines avancées que le SEA-UNSA approuve.
- La création du diplôme bac+3 « Bachelor agro » est validée. Il devra pour le SEA-UNSA permettre de former plus et accompagner la montée en compétences induite par la prise en compte des enjeux environnementaux. L’appellation « Bachelor agro » est finalement validée au risque d’entretenir la confusion avec les bachelors sans valeur réglementaire des établissements privés lucratifs. La lisibilité et la compréhension des parcours d’orientation par les jeunes et les familles ne vont pas en être simplifiées.
- La vocation pédagogique des exploitations des lycées agricoles est consacrée dans la loi (revendication de nos collègues du Snetap-FSU que nous partageons). Pour trouver une traduction concrète en établissement, il va falloir que les Régions intègrent systématiquement les exploitations et les ateliers technologiques dans leur plan prévisionnel d’investissement. Difficile à imaginer alors que certaines commencent à faire payer des redevances pour l’utilisation des locaux des CFA et des CFPPA
- En revanche, dans le champ de la formation professionnelle et de l’apprentissage, le SEA-UNSA désapprouve la possibilité laissée aux EPL de créer des centres uniques de formation et de fusionner les CFA et les CFPPA. Cette disposition, qui va dans le sens de la réforme de l’apprentissage de 2018, soulève de nombreuses interrogations règlementaires, au premier rang desquelles figure la gestion RH : comment vont s’harmoniser les protocoles des différents centres ? Sujet central alors que vont s’ouvrir les négociations entres les organisations syndicales et les employeurs sur le temps de travail des formateurs.
Dernier point et non des moindres, celui des objectifs affichés pour former plus et assurer le renouvellement des générations d’agriculteurs.
Les chiffres sont saisissants, maintenir en l’état la population agricole est un défi en soi. Près de la moitié d’entre eux est amenée à partir en retraite dans les dix prochaines années. Sans repreneur, le nombre des exploitants agricoles va poursuivre sa dégringolade et accentuer les phénomènes déjà observés de concentration des terres et d’agrandissement des exploitations. D’ici 2030, il faut trouver 100 000 actifs agricoles supplémentaires. Pour l’enseignement agricole, cela représente une augmentation de 30% du nombre de diplômés par les différentes voies de formations des EPL Pour cela, il va falloir inévitablement ouvrir de nouvelles classes, attirer les jeunes et créer des postes d’enseignants. Les estimations se situent autour de 200 ETP supplémentaires d’ici 2028, autant dire demain. Or, en toute cohérence, le ministère commence cette année par en supprimer 45 et fusionner ou fermer des classes…
Pour le SEA-UNSA, sans budget à la hauteur des enjeux, les objectifs ne pourront pas être atteints à l’horizon 2030.
Enfin, sur la question des vétérinaires, le SEA-UNSA dénonce le refus du ministère d’envisager l’ouverture d’une cinquième école publique à Limoges alors que quatre écoles publiques ne suffiront pas pour former 75% de vétérinaires en plus d’ici 2030. Le projet fait pourtant consensus au sein des acteurs concernés et auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine.