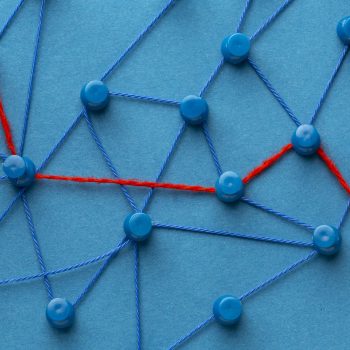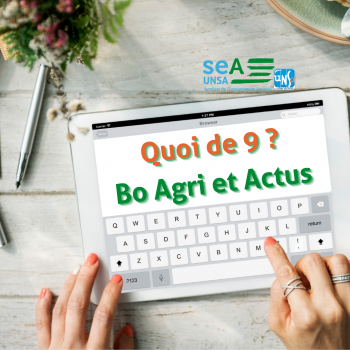Ce groupe de travail s’inscrit dans la continuité de l’engagement pris lors du premier groupe de travail du 28 mai demandé par les organisations syndicales. Il revêt toute son importance alors qu’on déplore l’attaque qui a eu lieu dans le lycée horticole d’Antibes.
Ce sujet sera aussi abordé lors de la formation spécialisée du CSA M du 13 novembre 2025.
Règles applicables en matière de protection fonctionnelle
Présentation de l’instruction technique du 17 juillet 2025 relative aux règles applicables en matière de protection fonctionnelle en cas d’attaque par Guillaume DE LA TAILLE LOLAINVILLE, Directeur des affaires juridiques.
La protection fonctionnelle est une obligation légale de l’employeur. L’administration ne protège pas l’agent s’il est victime de ses propres fautes.
Elle concerne les attaques suffisamment graves et certaines subies en raison des fonctions. Le but de la loi est l’intérêt général, il faut protéger les agents qui appliquent les politiques publiques. Cela s’entend à l’exclusion des procédures disciplinaires engagées à l’encontre des agents.
Normalement, les relations hiérarchiques entre le supérieur et l’agent ne sont pas couverts par le champ de la protection fonctionnelle (sauf harcèlement et comportements violents). Dans ces cas, c’est la cellule de signalement qui pourra être sollicitée. La moindre dispute ne relève pas de la protection fonctionnelle. En revanche, les atteintes physiques à la personne, les atteintes aux biens d’un agent, les menaces, le harcèlement, les remarques désobligeantes, le colportage de rumeurs désobligeantes relèvent de la protection fonctionnelle, les agents publics n’ont pas à subir ces attaques.
Un acte d’attaque qui ne relève pas de la fonction ou de la qualité de fonctionnaire de l’agent public, même si elle se déroule sur le lieu de travail, ne relève pas de la protection fonctionnelle.
L’obligation de la protection fonctionnelle incombe à tous les chefs de service, qui doivent prendre les mesures managériales et de proximité nécessaires.
Il appartient au chef de service de faire le signalement au titre de l’article 40, pas de porter plainte, dans le droit français. Il n’y a que la victime qui peut porter plainte, cependant elle peut être accompagnée dans cette démarche.
L’administration de doit pas se contenter de mesures insuffisantes, mais ne doit pas non plus utiliser des moyens démesurés. Dans des cas exceptionnels, l’administration peut refuser l’appui dans un souci d’apaisement ou d’intérêt général.
L’administration doit réparer intégralement les préjudices subis par la victime.
Un supérieur hiérarchique ne signe pas un papier de protection fonctionnelle, il le rédige. La protection fonctionnelle, c’est un certain nombre de mesures concrètes mises en place pour protéger l’agent. Seul le refus de prise en charge doit être motivé.
Les bénéficiaires sont les agents publics à l’exclusion des agents de droits privé qui relèvent du code du travail (dans lequel il faut chercher les réponses à apporter). Pour le cas de la protection de la famille, c’est la protection de l’agent qui bénéficie de la protection par ricochet, autrement la famille ne bénéficie que de la prise en charge des frais de justice.
L’autorité responsable de la protection fonctionnelle est celle qui assure la rémunération de l’agent à la date de l’attaque.
Dans les EPLEFPA les agents recrutés par le MAASA relèvent du ministre (contractuels et titulaires), les ACB relèvent de la protection fonctionnelle de l’établissement. La direction des affaires juridiques (DAJ) n’a pas le droit d’engager des dépenses publiques pour un agent qui n’est pas rémunéré par le ministère.
La direction des affaires juridiques assiste la structure en charge de l’agent pour la mise en place de la protection fonctionnelle.
Il faut avoir une description très précise pour la prise en charge de la protection fonctionnelle, factuellement : « date, heure, qu’est-ce qu’il s’est passé, ce qui doit être pris en charge, frais de justice, etc. »
Il est nécessaire de connaître ce dont le service a besoin pour instruire les demandes : Qui rémunère, qu’est-ce qui s’est passé, quels sont les besoins ?